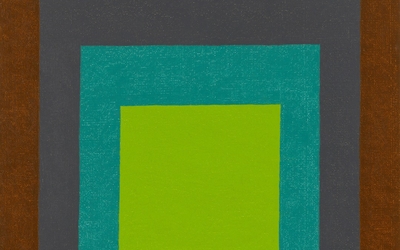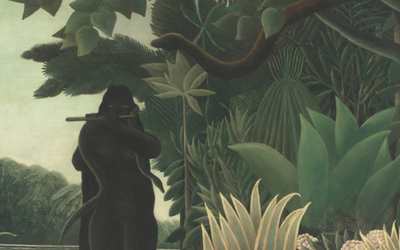5 photos qui vous donneront envie de découvrir le Paris d’Agnès Varda au musée Carnavalet
Sélection
Mise à jour le 11/04/2025

Sommaire
Le musée Carnavalet nous transporte dans le Paris d’Agnès Varda, cinéaste, mais aussi photographe. Parmi les 130 tirages (dont de nombreux inédits) qui y sont exposés, on en a sélectionné 5 qui vont vous donner envie d’admirer l’œuvre d’une artiste iconique.
La jeune et mystérieuse Agnès
Cette expo révèle une facette plus sombre d’Agnès Varda, plus intime, comme teintée d’une certaine noirceur. Sur cet autoportrait, l’artiste a 27 ans. On reconnaît les mythiques ailes d’ange utilisées dans son œuvre photographique, qu’elles soient suspendues à son atelier ou sur le dos d’une petite fille. En effet, en 1955, elle met en scène sa nièce, Christine d’Allens, déambulant dans les rues de Paris sous l’œil interrogatif, voire désapprobateur, des passants.
Comme cette série de clichés, cet autoportrait surréaliste révèle la poésie et la force d’Agnès Varda. Droite et immobile, elle se dresse face à l’objectif. Son regard, cerclé de fatigue, et sa coupe au bol emblématique évoquent une Jeanne d’Arc contemporaine. Un portrait austère, mystique, en décalage avec l’image souriante et espiègle que l’on associe souvent à la cinéaste.
Ses muses avant la rue Daguerre
Arrivée à Paris en 1948, Agnès Varda prend l’habitude d’immortaliser ses amies et colocataires. Devenues ses muses (ici, Valentine Schlegel et Frédérique Bourget), elles posent dans les différents recoins de Paris et constituent les premiers trésors photographiques de l’artiste. Dès ses débuts, on perçoit ce qui fera sa signature : capturer des moments de vie, des instants furtifs, touchants et spontanés, sans tricherie.
En 1951, elle s’installe au 86, rue Daguerre (14e) avec Valentine Schlegel, sa compagne de l’époque. À l’entrée de leur maison, une plaque en céramique orange (visible dans l’exposition), la représentant, avait été conçue par Valentine.
Agnès Varda, Valentine Schlegel et Frédérique Bourguet à Montmartre, Paris 18e, 1948-1949.
Crédit photo :
© Succession Agnès Varda
Sa cour-atelier, son refuge
On sous-estime peut-être l’importance de la cour-atelier de la rue Daguerre (14e) dans la vie d’Agnès Varda. Ce n’était pas seulement un lieu de création, c’était un véritable microcosme où l’artiste vivait entourée de ses voisins et amis, qu’elle a beaucoup photographiés.
Parmi eux, Alexander Calder, que l’on voit ici riant joyeusement, tenant l’une de ses sculptures mobiles, au milieu de la rue, contrastant profondément avec un autre portrait marquant de Calder, entouré de sa famille, assis sur un banc du boulevard Saint-Germain (6e), en 1954. Alignés, posant de la même manière, ils regardent l’objectif, avec une expression impassible. Car Agnès Varda aimait autant shooter les célébrités (l’auteur Eugène Ionesco ou le photographe Brassaï) qu’elle côtoyait, que les anonymes croisés au détour d’une rue.
Agnès Varda, Alexander Calder devant son atelier, Paris 14e, octobre 1954.
Crédit photo :
© Succession Agnès Varda / 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris
Son obsession pour les gens
« Je crois que les gens, c’est tout de même ce qu’il y a de plus intéressant », déclarait Agnès Varda. Comme pour illustrer sa pensée, la photographe n’a eu de cesse d’immortaliser des passants, telle cette vieille femme un peu sévère, revenant du marché rue Mouffetard (5e). Les commerçants, les marginaux, les oubliés, les ouvriers : tout le monde suscitait l’intérêt de l’artiste.
En février 1957, elle colle ses tirages dans un grand cahier noir qu’elle intitule « L’Opéra-Mouffe », qui deviendra un court-métrage en 1958. Agnès Varda avait un don : rendre visible l’invisible. Cette fascination pour les gens se concrétise avec Daguerréotypes (1974), un film réalisé à 90 mètres de chez elle, pour rester proche de son petit garçon, Mathieu Demy, alors âgé de 2 ans.
Son éternelle excentricité
L’expo se clôt par des portraits de celle qui aimait tant photographier les autres. Un petit film nous la montre de ses débuts à la fin de sa carrière. Son portrait diaboliquement angélique, en noir et blanc, détonne avec celui-ci, en couleurs et pris soixante-huit ans plus tard.
Figée dans sa très chère cour-atelier, elle plante un regard espiègle dans l’objectif, cachée derrière des lunettes de soleil de style hippie, vêtue d’un imposant manteau rouge sur le dos et coiffée de sa désormais mythique coupe au bol bicolore. On y retrouve tout le génie d’une photographe terriblement attachante…
Séance pour « Interview Magazine », 22 juillet 2018, n° 521.
Crédit photo :
©Courtesy Collier Schorr
-
Durée de l’exposition : comptez 2 heures
Zélie B.
Default Confirmation Text
Settings Text Html
Settings Text Html
Votre avis nous intéresse !
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).
Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.
À lire aussi
Vous ne connaissez toujours pas ?
Sélection des bons plans intemporels, mais qui valent le coup toute l'année !